Vendredi dernier, j’étais convié par l’OFB et la Fédération nationale des chasseurs à célébrer le 1000ᵉ projet financé par l’écocontribution. C’est à Saint-Mars-la-Brière, dans la Sarthe, que nous nous sommes retrouvés autour d’élus locaux et de la Fédération des chasseurs de la Sarthe pour parler de la renaissance d’un étang, sanctuaire de biodiversité.
Derrière cette renaissance, il y a une idée simple, née de la loi du 24 juillet 2019 : l’écocontribution. Chaque chasseur, en validant son permis annuel, participe à hauteur de 5 euros à un fonds dédié à la biodiversité, tandis que l’Office français de la biodiversité (OFB) ajoute 10 euros de plus. Ensemble, ces petites sommes deviennent une force colossale : près de 15 millions d’euros mobilisés chaque année pour restaurer la nature, du littoral breton aux forêts provençales.
L’étang de Saint-Mars-La-Bière, qui s’étend sur 23 hectares au cœur d’un vaste site Natura 2000 de plus de 4 500 hectares, souffrait depuis plusieurs années d’un manque d’eau chronique. Chaque été, les niveaux baissaient dangereusement, mettant en péril les habitats des oiseaux d’eau, des amphibiens et de toute la faune aquatique. Il fallait agir, et vite.
Sous l’impulsion de la Fédération départementale des chasseurs de la Sarthe, et avec le soutien du Conseil départemental, de l’OFB, de la Direction départementale des Territoires et du Syndicat de bassin, un ambitieux chantier de réhabilitation a été lancé. Même les élèves de la Maison Familiale et Rurale de La Ferté-Bernard ont prêté main forte, apportant leur énergie et leur curiosité à cette aventure humaine et écologique.
Pendant deux ans, entre 2020 et 2021, on a vu ce lieu se transformer. Le vieux bras du Narais, étouffé par la végétation, a été dégagé et restauré sur près de 400 mètres. Un fossé a été creusé pour reconnecter le cours d’eau à l’étang, des berges ont été consolidées, et un système de bonde moderne installé pour réguler le niveau de l’eau. De petits seuils en pierre ont même été ajoutés pour relever la ligne d’eau de vingt centimètres, un détail technique, certes, mais aux conséquences majeures pour la vie aquatique.

Aujourd’hui, le résultat saute aux yeux : l’eau circule à nouveau, les zones humides reprennent leur souffle, et la faune revient. Lors de cette visite guidée du site j’ai pu constater par moi même la présence de nombreuses espèces aquatiques, mais également d’anatidés tel que des milouins. Un vrai régale.
Cette réussite, c’est celle d’un travail collectif. Celle d’une coopération exemplaire entre institutions, chasseurs, techniciens et citoyens. Les fonds issus de l’écocontribution ont permis de donner vie à un projet concret, durable et mesurable.
Mais ce n’est pas un aboutissement : le site fera désormais l’objet d’un suivi attentif, mené conjointement par le Conseil départemental, l’OFB et la DDT. Car restaurer la nature, ce n’est pas seulement reconstruire : c’est aussi accompagner sa résilience.
En quittant l’étang ce jour-là, je me suis dit que chaque euro versé par un chasseur, chaque heure passée sur le terrain, chaque geste collectif avait un sens. La nature, quand on lui tend la main, sait toujours nous remercier.





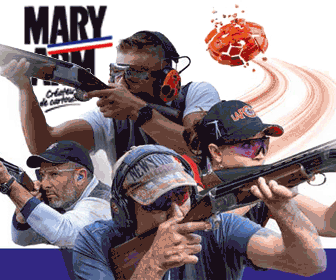


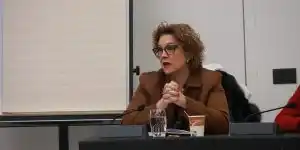








![[Vidéo] Un chamois se sort in extremis d’une avalanche](https://www.chassepassion.net/wp-content/uploads/2026/02/chamois-avalanche.webp)

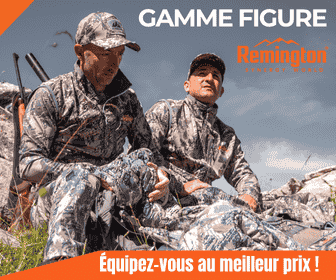
4 réflexions sur « Écocontribution : le cap des 1000 projets franchi. Retour sur l’un d’entre eux »
bizarre recreuser un fossé et ne pas se retouver devant un tribunal il y a du laisser aller dans l autorité (alors que degager un tas de branche vous condamne a 50.000 euros )
Les chasseurs payent pour le zones NATURA 2000 , repère d’écolos. Pourquoi Brigitte Bardot et Bougrain-Dubourg ne financent pas ca ?
Ou sont les HUGO CLEMENT roi des emmerdeurs
Ca va mal finir tout ca !!!
La réhabilitation de cet etang est intéressante, dommage qu’elle soit située au milieu d’un massif forestier qui concentre les marchands de chasse pour lesquels les populations de grande faune ne sont jamais suffisantes. Celles- ci causent d’énormes dégâts agricoles et forestiers, jusque dans le cœur des communes environnantes, . une battue administrative vient d’être effectuée dans l’une d’entre elle, Monfort le Genois où 17 sangliers qui débordaient des propriétés des marchands de chasse, ont été abattus à 2 pas des maisons du bourg.
Monsieur Cheval , il aurait été bien que l’OFB et La FÉDÉ de chasse vous conduisent vers les sentiers recouverts de maïs (nourrissage) ou vers les tas de pommes de terre déversés dans les recoins de la forêt.
Malheureusement , ces gens ne font pas leur boulot, si ce n’est approcher des concentrations animalière, comme sur la photo , l’agent de l’OFB qui scrute les animaux comme dans un zoo, sans jamais agir sur les pratiques délictueuses des marchands de chasse. Ces directives de travail ne les intéressent pas, seule compte l’observation béate des animaux , oubliant de faire respecter les lois.
Pendant ce temps les victimes , du pourtour de ce massif forestier n’en peuvent plus de cette incurie. Outre les destructions agricoles, beaucoup d’autres dégâts ne sont pas indemnisés, les destructions forestières, les destructions automobiles avec les cohortes e blessés ou de morts, les destructions des jardins publics, privés comme à Monfort le Genois, les destructions de terrains de sports.
Le grand sujet ne se situe pas dans les indemnisations agricoles par les impôts de tous les citoyens, mais dans la très forte réduction des populations destinées au jeu du tir de quelques uns pendant 3 à 4 journées par an.
Bonjour,c’est très bien!il faudrait aussi faire cotiser toutes ces sangsues adeptes des subventions au bénéfice de rien,si ce n’est passer son temps au tribunal pour emmerder le monde.