Chaque année, les majestueux flamants roses reviennent nicher dans les lagunes du delta de l’Èbre, en Catalogne. Pourtant, la saison 2025 s’est soldée par un échec partiel : malgré la présence de 1 510 couples dans les salines de Trinitat, à La Ràpita, seulement 312 poussins ont survécu, selon les données publiées par le gouvernement catalan. En moyenne, cela représente 0,21 poussin par couple, soit bien en dessous du taux habituel de 0,51.
Les principales causes de cette baisse de productivité sont identifiées : une prédation intense, notamment par les goélands argentés et les renards, a ravagé les premières semaines de vie des jeunes flamants. Le phénomène a été si marqué qu’il a empêché le déroulement de l’opération annuelle de baguage scientifique, faute de poussins suffisamment développés.
Depuis 1992, le delta de l’Èbre s’est imposé comme un site majeur de reproduction pour les flamants roses, le seul en Catalogne et l’un des rares autour de la Méditerranée. La colonie y a connu une croissance importante, avec un pic historique de 4 303 couples en 2020. Mais cette population reste soumise à de fortes variations. Entre 2013 et 2016 déjà, les couvées avaient été lourdement affectées par la prédation.
Le triste scénario de 2025 remet en lumière la fragilité de cet équilibre. Bien que le site bénéficie d’un statut de protection en tant que parc naturel, les menaces, naturelles ou liées à l’activité humaine, pèsent lourdement sur cette espèce emblématique.
Le baguage des poussins est une étape cruciale dans le suivi des flamants roses. Chaque été, les jeunes sont équipés d’un anneau métallique leur permettant d’être identifiés et suivis au fil de leurs migrations. Grâce à ce programme, lancé il y a plus de 30 ans, plus de 5 000 individus ont été bagués dans le delta de l’Èbre, donnant lieu à plus de 27 000 observations à travers 17 pays, du Portugal à Israël, du Sénégal à la France.
Mais cette année, l’opération a dû être annulée : trop peu de jeunes avaient atteint la taille requise. Une absence de données qui prive les scientifiques d’un précieux outil de suivi dans un contexte de changements climatiques et de pression croissante sur les zones humides.













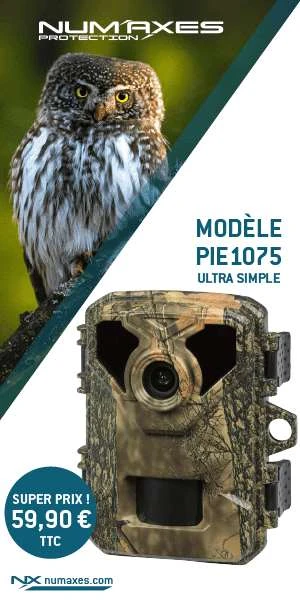
![[Vidéo] Un chien de chasse chassé par des sangliers](https://www.chassepassion.net/wp-content/uploads/2026/01/chien-charge-par-un-sanglier.webp)

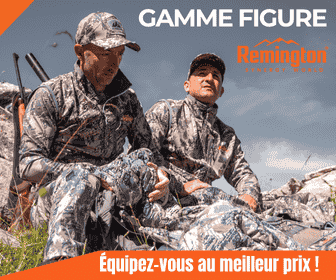
9 réflexions sur « Renards et goélands ont décimé la reproduction des flamants roses en Espagne »
j’habite à la campagne et les renards ne mangent pas que des mulots, ils tue mes poules et en plein jour, quand elles sont lâchées dans le poulailler. Il n’y a que les lapins qui n’ont jamais réussi à tuer car les cages sont en bétons et le grillage des portes est très solide.
Les escrolos du dimanche vont peut être ouvrir les yeux et comprendre que les renards sont des prédateurs qu’ils faut réguler (chez moi ils mangent mes poules et pas que les mulots) ainsi que les goélands et cormoran ou alors expliquez à ces animaux qu’ils doivent devenir végans et ils se mettront à brouter tout le monde sera content
Bonjour, que pensez vous du piégeage du renard 🦊 ?
Soit disant, pour réguler, cervidés et cochons, qui n’ont pas de prédateurs, on réintroduit, des lynx, des loups, et des ours; apparemment les instigateurs sont satisfaits, car même les troupeaux de brebis sont régulés.
Que comptez vous faire, pour réguler les renards et les goélands, je m’adresse aux « penseurs » , Français et Espagnols apparemment il doit rester encore pas mal de flamants.
Allez à très bientôt, car ce n’est que le début, car nous piégeurs, nous ne pouvons plus rien réguler. Quelque part , c’est bien fait pour vos gueu….!!!!
c’est surement pas des renards ,ils mangent que des mulots ,c’est pas moi qui le dit ;
Moi qui pensais que les renards ne mangeaient que des mulots, certains sites seraient-ils là pour nous tromper? ne vous inquiétez pas c’est un semblant d’humour!
Ils disent quoi l’ASPAS et même la LPO ?.
D’après ces associations écolo , il ne faut pas réguler le renard .
Bonjour,toujours la même histoire ‘mauvaise gestion ‘alors on veut que des renards et des goélands,ou des flamands roses aussi! Alors ‘ON RÉGULE ‘LES PRÉDATEURS EN SURNOMBRE !!!!.(même problème aux pays Bas avec les barges)
Comment?les renards ne mangent que des mulots et les goélands nettoient nos décharges,mais d après certains tout se régule et vit en Harmonie le monde de Walt Disney quoi!dans le marais,rapaces,corbeaux,herons, viennent a bout de quasiment toutes les nichées de ralides,de. canards.il leur reste les écrevisses américaine et les grenouilles taureau car le reste a disparu.il faudrait peut être que la LPO ouvre les yeux , personne a attaquer,pas d argent a prendre comme pour le cinéaste qui les a survoler en Camargue.