Bicyclettes, machines à coudre, cannes à pêche et évidemment, fusils de chasse, si l’on voulait réaliser un achat de ce type, le premier réflexe dès le début des années 1900 était de se tourner vers une seule et même entreprise : Manufrance.
De son nom complet la Manufacture Française d’armes et cycles de Saint-Étienne, plus connue aujourd’hui sous son nom commercial « Manufrance », son histoire touche forcément de nombreuses générations qui ont connu son célèbre catalogue et les produits vendus sur celui-ci.
Des plus hautes sphères du succès à sa quasi disparition, la vie de cette entreprise a été marquée par de nombreux évènements. La disparition de la majorité des industries Françaises suite à la mondialisation, qui avait à l’époque été fatale à de nombreux fabricants Français, n’a pas épargné cette Manufacture. Revenons sur les premières années de cette entreprise qui a bousculé les codes et a su s’imposer dans des milliers de foyers Français.
 La création d’un géant.
La création d’un géant.
La Manufacture Française d’armes et cycles de Saint-Étienne voit le jour premièrement sous le nom de « Manufacture Française d’armes de chasse et de tir » en 1885. Etienne Mimard et Pierre Blachon, deux armuriers de formation, décident de s’associer pour racheter l’entreprise de Jacques Claude Martinier-Collin, une maison de commerce située en bas du Cours Fauriel à Saint-Etienne.
Peu après avoir démarré leur activité, la fabrication de vélocipèdes est annexée à la Manufacture sous le nom de marque « Hirondelle ». La fabrication de bicyclettes nécessitant des matières premières et des savoir-faire équivalents à l’armurerie, l’association de ces deux activités fut un avantage considérable dans le développement de l’entreprise.
Entre 1890 et 1895, la société se diversifie encore en faisant l’acquisition d’une autre entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente d’articles de sport et en créant un magasin spécialisés dans les articles de pêche.
La prospérité de la Manufacture évoluant très rapidement, elle se retrouve assez vite à l’étroit dans ses premiers locaux et déménage un peu plus loin dès 1894. C’est l’occasion pour l’entreprise de redéfinir son activité à travers de nouveaux statuts :
« La présente société aura pour objet la fabrication et la vente de toutes armes de chasse et de guerre, de toutes munitions et accessoires de chasse et de pêche ; de la fabrication et la vente de tous vélocipèdes, bicyclettes, tricycles et tous appareils et accessoires de vélocipédie ; la construction mécanique, l’achat, la fabrication et la vente de toutes marchandises et de tous objets généralement quelconques, ainsi que toutes opérations commerciales s’y rattachant ». Statuts officiels issus des archives de 1894.
 La montée en puissance de la Manufacture.
La montée en puissance de la Manufacture.
En 1902, l’importance et le succès rencontré par la bicyclette contraint la société à modifier sa dénomination et c’est là qu’elle prend le nom de « Manufacture Française d’armes et cycles de Saint-Étienne ».
En 1903, la Manufacture double sa superficie pour atteindre plus de 40.000m².
Pour mieux comprendre à quel point la Manufacture a été un succès sur ces années, il suffit de citer Étienne Mimard, l’un des fondateurs qui s’exprimait sur un document prévu pour les expositions universelles de l’époque :
« Lorsqu’en 1885, nous prîmes en main l’exploitation de la Manufacture française d’armes, son chiffre d’affaires annuel était de 350.000 francs et elle occupait un personnel de 25 personnes. […] Aujourd’hui, le chiffre d’affaires est de HUIT MILLIONS et le personnel de 1.750 personnes ».
La compagnie devient célèbre grâce aux technologies qu’elle développe ainsi qu’à la qualité de ses fabrications comme le fusil « Idéal » un des premiers fusils sans chiens extérieurs.
Elle bénéficie également d’un réseau de distribution important au niveau national et même jusque dans les colonies Françaises ou des pays étrangers.
Le coup de force de la Manufacture a également été d’entretenir sa notoriété à travers une publication sur la chasse en France qui deviendra plus tard le Chasseur Français. Comme Manufrance, ce journal est tombé en désuétude avec les années avant d’être revendu et ne retrouvera jamais sa place dans le cœur des chasseurs Français.
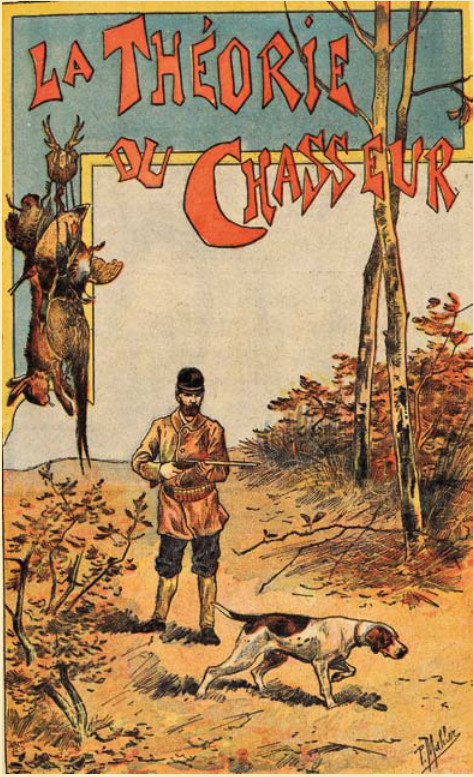
« La présente société aura pour objet la fabrication et la vente de toutes armes de chasse et de guerre, de tous accessoires et munitions de chasse, la fabrication et la vente des cycles, des machines à coudre, des machines à écrire, ainsi que tous leurs accessoires, la construction mécanique, l’achat, la fabrication et la vente de toutes marchandises et de tous objets généralement quelconques, l’achat et la vente de tous brevets d’invention, l’obtention et la concession de toutes licences, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus. Elle aura également pour objet la publication et l’exploitation du journal Le Chasseur Français, feuille mensuelle et, le cas échéant, tous journaux ou autres feuilles que la Société pourra créer, acquérir ou affermer. » Statuts officiels issus des archives de 1911.
La première moitié du XXe siècle, période chaotique pour Manufrance.
Comme pour de nombreuses entreprises, cette période en France a été chaotique pour diverses raisons.
Tout d’abord, Manufrance doit faire face à un premier évènement mondial de taille quand va éclater la Der des Ders. Pendant la première guerre mondiale, l’impact économique est terrible et l’effort de guerre oblige l’entreprise à se remettre en état avant de pouvoir songer à reprendre une activité économique viable et pérenne.
Si par la suite, la Manufacture reprend du poil de la bête, deux années vont être très compliquées à gérer d’un point de vue économique et social pour les dirigeants qui devront faire face à de grandes difficultés.
En 1929, le krach boursier aura un impact sur toute l’économie et par conséquent, va aussi jouer sur les résultats financiers de la firme qui affichera pour la première fois un bilan de fin d’année négatif. C’est un coup dur pour la Manufacture qui avait su remonter la pente après la guerre.

A l’époque, tous les employés travaillant pour Manufrance ne dépendent pas de la convention collective métallurgie mais souhaitent tous bénéficier de ce même régime. La grève qui bloque totalement la fabrication et les livraisons sera très mal vécue par Étienne Mimard qui est alors le grand patron de Manufrance. Ce dernier voit la grève de ses employés comme un mouvement politique et va alors tous les licencier.
L’occupation de ses usines par les grévistes reste un moment fort de la bataille menée par les syndicalistes ouvriers. Lorsque la justice autorise l’évacuation des grévistes des bâtiments de Manufrance, des heurts éclatent et vont obliger le chef d’entreprise à revoir ses plans.
Finalement, Etienne Mimard se verra contraint à embaucher de nouveau ses salariés sur la base d’un nouveau contrat collectif et devra procéder à des augmentations de salaires.
Très amer face à une telle conclusion, le fondateur de Manufrance attaquera les leaders grévistes dans les mois qui suivent et il parviendra à les faire condamner.
La seconde guerre mondiale.
La seconde guerre mondiale sera une période charnière pour l’entreprise qui sera secouée aussi bien par des évènements externes qu’internes.
Lorsque le conflit éclate, la Manufacture est forcément placée une nouvelle fois dans la tourmente. Au niveau économique les résultats sont désastreux et l’occupation d’une partie de la France par les allemands favorise les tentatives de réquisitions du matériel et des hommes par le régime de Vichy.
Dans ce conflit, le patron va jouer un rôle de trublion face au nouveau régime qu’il qualifie de « véritable dictature ». Étienne Mimard refusera de laisser les autorités intervenir pour faire partir le personnel en Allemagne, il n’acceptera pas de communiquer les états de son personnel et refusera de travailler pour l’occupant.

Jusqu’ici, la Manufacture Française d’armes et cycles de Saint-Étienne était dirigée d’une main de fer par Étienne Mimard, devenu seul président du conseil d’administration et directeur général après que Pierre Blachon ait été contraint de se retirer pour des raisons de santé.
Les choses vont pourtant changer puisque en juin 1944, Etienne Mimard décède subitement à l’âge de 82 ans.
Il se fera enterrer dans une tombe face à son entreprise comme pour pouvoir garder un œil sur elle pour toujours.
La suite de la saga Manufrance sera publiée dans un prochain épisode, pour ne rien manquer de cette saga, n’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter en bas de page ou à nous suivre sur notre page Facebook !
Sources : Loire.fr et saint-etienne.fr, informations, contenus et images d’archives.




 La création d’un géant.
La création d’un géant. La montée en puissance de la Manufacture.
La montée en puissance de la Manufacture.









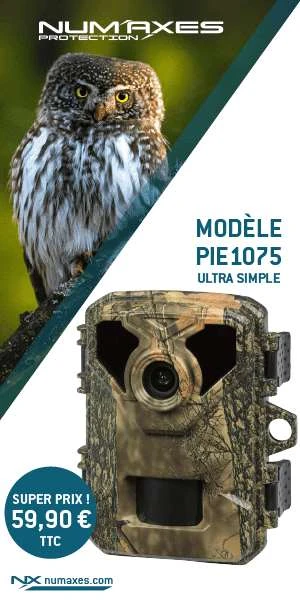
![[Vidéo] Une charge de sanglier sous haute tension en plein sur la ligne de postés](https://www.chassepassion.net/wp-content/uploads/2026/01/charge-sanglier-sur-la-ligne.webp)


Une réflexion sur « La saga Manufrance : la création d’un géant de l’armurerie et de l’industrie »
J’ai travaillé à la soop en temps armurier jusqu’à ce qu’elle ferme c’est porte en 1984.